Dans « si c’est un homme » (1947, 1958 et 1976), Primo Levi raconte son expérience de « Haftling », prisonnier – esclave au camp de Monowitz, l’un des « Lager » dépendant d’Auschwitz.
Initialement tiré à 2.500 exemplaires en 1947, le livre n’a connu le succès, et un succès planétaire, qu’avec sa réédition en 1958 par Einaudi. Levi fut ensuite sollicité par une multitude d’écoles pour donner son témoignage. Il synthétisa les questions les plus fréquemment posées et ses réponses dans un appendice en 1976.
J’ai lu « se questo è un uomo » et sa suite, « la tregua » dans le cadre de mon apprentissage de l’Italie et de sa langue il y a une quinzaine d’années. J’ai relu le premier livre en français dans le cadre d’un cours de littérature à l’Université de Bordeaux.
Probablement sous l’influence de sa formation scientifique comme chimiste, Primo Levi adopte un point de vue descriptif. Il raconte ce qu’il a vécu comme déporté et comme travailleur forcé d’une usine chimique de IG Farben. Si les chambres à gaz sont absentes de son récit, c’est qu’il n’en a pas été témoin oculaire.
Un témoignage
Son discours n’est pas celui d’un indigné ou d’une victime. Il raconte ce qu’il voit, et ce qu’il voit est insoutenable. « De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu’on peut avoir quand on a sauté un repas, de même notre façon d’avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons « faim », nous disons « fatigue », « peur » et « douleur », nous disons « hiver », et en disant cela nous disons autre chose, des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vivent dans leurs maisons et connaissent la joie et la peine. Si les Lager avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d’une âpreté nouvelle ; celui qui nous manque pour expliquer ce qu’est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec, pour tous vêtements, une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche. »
Le « Haftling » (détenu dans un Lager) qui croit possible de s’en sortir avec les rations dérisoires de soupe et de pain et de travailler au rythme exigé par les Kapos entre rapidement dans un cercle vicieux d’épuisement dont il ne sortira, disent les détenus, « que par la cheminée ». La survie exige de « s’organiser », c’est-à-dire de voler et d’alimenter des trafics où l’on échange des demi-rations de pain contre un morceau de métal ou un savon volés à l’usine, et au besoin de voler les codétenus. Pour continuer d’exister ne serait-ce qu’un jour de plus il faut, dit Levi, vivre « en deçà du bien et du mal ».
Les champions dans l’art de la survie sont les juifs de Salonique, qui parlent un mélange d’espagnol (ils sont descendants des Juifs expulsés d’Espagne en 1492) et de grec. « … Ces admirables et terribles juifs de Salonique, tenaces, voleurs, sages, féroces et solidaires, si acharnés à vivre et si impitoyables dans la lutte pour la vie ; de ces Grecs qu’on trouve partout aux premières places, aux cuisines comme sur les chantiers, respectés par les Allemands et redoutés par les Polonais. Ils en sont à leur troisième année de détention, et ils savent mieux que quiconque ce qu’est le Lager. Les voici maintenant regroupés en cercle, épaule contre épaule, en train de chanter une de leurs interminables cantilènes ».
Le regard des civils sur les « Haftling »
Voici comment les civils de l’usine de caoutchouc voient les « Haftling » : « ils nous entendent parler dans toutes sortes de langues qu’ils ne comprennent pas et qui leur semblent aussi grotesques que des cris d’animaux. Ils nous voient ignoblement asservis, sans cheveux, sans honneur et sans nom, chaque jour battus, chaque jour plus abjects, et jamais ils ne voient dans nos yeux le moindre de signe de rébellion, ou de paix, ou de foi. Ils nous connaissent chapardeurs et sournois, boueux, loqueteux et faméliques et, prenant l’effet pour la cause, nous jugent dignes de notre abjection. »
Outre la conscience précoce du mode de fonctionnement du camp, un sens de la combine et une bonne dose de chance, ce qui a permis à Primo Levi de survivre est le désir profond de témoigner de cet enfer. C’est aussi la rencontre d’un petit nombre d’hommes d’une qualité rare. C’est le cas d’Alberto. « Alberto est mon meilleur ami. Il n’a que vingt-deux ans, deux de moins que moi, mais témoigne de capacités d’adaptation que personne, dans notre groupe d’Italiens, n’a su égaler. Alberto est entré au Lager la tête haute, et vit au Lager sans peur et sans reproche. Il a compris avant tout le monde que cette vie est une guerre ; il ne s’est accordé aucune indulgence, il n’a pas perdu de temps en récriminations et en doléances sur soi ni sur autrui, et il est descendu en lice dès le premier jour. Il a pour lui l’intelligence et l’instinct : il raisonne juste, souvent il ne raisonne pas et il est quand même dans le vrai. Il saisit tout au vol : il ne connait qu’un peu de français et comprend ce qu’on lui dit en allemand et en polonais. Il répond en italien et par gestes, se fait comprendre et s’attire immédiatement la sympathie. Il lutte pour sa propre vie, et pourtant il est l’ami de tous. Il « sait » qui il faut corrompre, qui il faut éviter, qui on peut amadouer, à qui on doit tenir tête. »
Des hommes debout
Un autre juste est Lorenzo. L’histoire de mes rapports avec Lorenzo, écrit l’auteur, « se réduit à peu de chose : tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil italien m’apporta un morceau de pain et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une carte postale qu’il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et n’accepta rien en échange, parce qu’il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût rapporter quelque chose ».
Alberto mourut dans la marche de la mort consécutive à l’évacuation d’Auschwitz, et Lorenzo de dépression quelques années après la libération. C’est en partie grâce à eux que Primo Levi a trouvé la force de survivre et que nous pouvons lire aujourd’hui son témoignage bouleversant, un vaccin puissant contre l’envie toujours latente de considérer « l’autre » comme intolérable, jusqu’à l’extrémité de faire de lui une vermine tout juste bonne à être gazée.

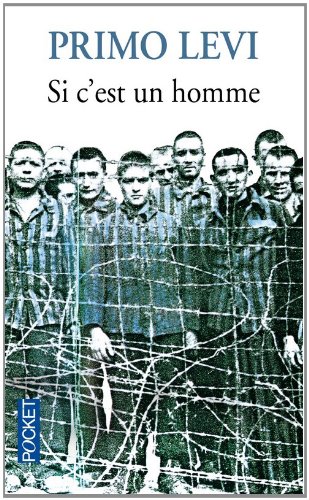
J’ai toujours lu ce livre avec l’ombre portée sur lui du suicide de Primo Levi. Cf. la 4° de couverture de l’édition « pocket » : « Né à Turin en 1919, Primo Levi s’est donné la mort en avril 1987. » Or je découvre aujourd’hui que les circonstances de sa mort sont loin d’être aussi sûres. Cf. Wikipedia : « La question de la mort de Primo Levi est importante. En effet, son œuvre est communément interprétée comme une puissante affirmation de la vie face à des puissances violentes et guerrières organisées. Le fait qu’il soit mort volontairement ou par accident constitue donc un commentaire final sur la validité de son propre message, lucide, positif et humaniste. L’interprétation d’Elie Wiesel, qui défend la thèse du suicide, a été acceptée jusqu’à ce jour, sans que l’on sache encore si elle est fondée sur des faits ou sur une intuition personnelle. »