L’avènement de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis devrait nous inciter à méditer les leçons de l’histoire. « The march of folly », de Barbara Tuchman (1984) constitue une référence incontournable.
Le livre de Barbara Tuchman (1912 – 1989) a été traduit en français sous le titre : « la marche folle de l’histoire ». Cette traduction n’est pas heureuse : c’est en effet de la folie des gouvernants qu’il est question, ainsi que le précise le sous-titre, « de Troie à la guerre du Vietnam ».
Tuchman écrit : « un phénomène remarquable tout au long de l’histoire, indépendamment du lieu ou de la période, est la poursuite par des gouvernements de politiques contraires à leurs propres intérêts. L’humanité, semble-t-il, obtient de plus piètres résultats dans le gouvernement que dans presque toute autre activité humaine. »
Ce qui caractérise la folie d’un gouvernant
Les exemples abondent. L’auteur en sélectionne quatre : la folie des dirigeants troyens à laisser entrer dans les murs le monumental cheval laissé par les Athéniens après leur apparente retraite ; la folie des papes de la Renaissance, incapables de discerner le scandale que leur comportement provoquait chez les croyants et qui allait provoquer la dissidence protestante ; la folie des gouvernants britanniques qui croyaient pouvoir réduire par la force la résistance des colons américains à la levée de nouvelles taxes ; la folie des présidents américains à mener la guerre au Vietnam, sans tirer les leçons de la bataille de Diên-Biên-Phu.
Barbara Tuchman applique à ces quatre histoires une grille d’analyse précise. « Pour être qualifiée de folie selon cette enquête, la politique adoptée doit satisfaire trois critères : elle doit avoir été perçue comme contre-productive de son temps, et pas seulement avec le recul ; ensuite, une manière d’agir alternative devait avoir été disponible ; pour dissocier le problème de la personnalité, un troisième critère doit être que la politique en question doit avoir été le fait d’un groupe, non d’un gouvernant individuel, et persister au-delà de la vie politique d’une personne. »

Les papes font le lit du protestantisme
De 1470 à 1530, six papes de tempéraments différents se sont succédés à Rome. Certains furent des faibles dépassés par les événements, d’autres des guerriers. Mais ils avaient en commun la culture des princes italiens de leur époque : la recherche sans frein du pouvoir et de la richesse à leur profit personnel et à celui de leur famille. Ils en oublièrent totalement le message du Christ, nommèrent à des postes ecclésiastiques des enfants, pratiquèrent l’assassinat, menèrent une vie dépravée, vendirent les charges ecclésiastiques et les indulgences. Ils eurent l’illusion d’une inviolabilité de leur pouvoir et de leur statut : ils avaient à leur service l’inquisition et les bulles d’excommunication. Ils ignorèrent superbement les mouvements sociaux et religieux qui se réclamaient de l’Évangile contre la papauté. Et puis vint Luther.

Les Anglais perdent l’Amérique
En vingt ans, de 1763 à 1783, la Grande Bretagne réussit à perdre sa colonie d’Amérique alors que l’idée d’indépendance n’avait initialement pas cours. Simplement, si les colons acceptaient de payer des taxes à la Couronne, ils voulaient les décider eux-mêmes. Cette insubordination parut insupportable au Roi et au Parlement.
« Essentiellement, écrit Tuchman, le problème était celui de l’attitude. Les Britanniques se comportaient – et plus encore pensaient – en termes impériaux comme des gouverneurs face aux gouvernés. Les colons se considéraient comme des égaux, étaient allergiques aux interférences et reniflaient de la tyrannie dans chaque vent venu de par-delà l’Atlantique (…) Le sentiment de supériorité conduit à l’ignorance du monde et des autres parce qu’il supprime la curiosité. »
Ce sentiment de supériorité découlait d’un vice interne au système parlementaire britannique à cette époque, reposant essentiellement sur des titres de noblesse et des charges attribuées selon un principe de patronage. Le Devon et la Cornouaille avaient soixante-dix députés, alors que Manchester et Birmingham n’en avaient aucun et Londres seulement six.
Le Parlement, pas plus que le Roi George III, obtus de tempérament, ne pouvaient « voir » le problème existant avec les colonies. Sa politique, imposer des taxes avant de devoir les abroger, avancer avant de reculer, faire et défaire fut dans les faits incohérente. Mais outre-Atlantique, on perçut au contraire une grande cohérence, celle de la tyrannie.
Une fois décidée une politique de réduction par la force de la sédition, que l’Angleterre n’avait pas moyen de mener à bien à 6000km de distance, il fallut aller jusqu’au bout. « Les acteurs de la folie réalisent parfois qu’ils y sont engagés mais ne peuvent rompre le schéma… Le roi George III ne pouvait tout simplement pas concevoir de présider à la défaite. »
Une autre politique aurait-elle été possible ? Oui, laisser les colons prélever leurs propres impôts et discuter avec eux de la part revenant à la Couronne. Mais, arcbouté sur principe de sa souveraineté, le système politique anglais n’y était pas prêt.

Les Américains s’enlisent au Vietnam
Les deux guerres du Vietnam, celle menée et perdue par la France avec le soutien américain (1945 – 1954) puis celle menée et perdue par les Américains eux-mêmes (1954 – 1973) constituent un autre cas éclatant de « folie ».
On y trouve tous les ingrédients de la folie telle que définie par Tuchman : la croyance en la supériorité des Occidentaux sur les Asiatiques et la sous-estimation permanente de l’ennemi ; la méconnaissance des réalités régionales, et en particulier de la puissance des nationalismes ; l’érection de dogmes indubitables, comme la « théorie des dominos » ; et aussi « la dissonance cognitive, qui consiste à supprimer, enjoliver, minimiser ou diluer des problèmes qui pourraient produire des conflits ou une douleur psychologique au sein d’une organisation » ; la propension à s’imaginer qu’il n’existe pas d’alternative à la voie qu’on a choisie ; la persistance dans l’erreur, même si elle provoque des ravages insensés.
Plusieurs passages de Tuchman relatifs à la guerre du Vietnam sont intéressants. Elle écrit que « le but de la guerre n’était pas la conquête mais la coercition. La force serait utilisée selon une base rationnellement calculée de manière à altérer la volonté et les capacités de l’ennemi jusqu’au point où terminer le conflit serait plus avantageux que le continuer… La prise en compte du facteur humain n’était pas le point fort de McNamara et la possibilité que l’être humain ne soit pas rationnel était trop excentrique et troublante pour être programmée dans ses analyses. » On reconnait là la structure de pensée utilitariste, qui fit aussi des ravages en économie politique.
Le cynisme des dirigeants américains est également remarquable. Robert McNamara : « nous avons le pouvoir de rejeter n’importe quelle société hors du vingtième siècle. » Maxwell Taylor : « nous voulions que Ho et ses conseillers aient le temps de méditer sur la perspective d’une mère patrie démolie ».
Le prince doit être un questionneur
Barbara Tuchman voit un antagonisme entre l’exercice du pouvoir et la pensée. Le puissant n’aime pas la contradiction, et ses courtisans le savent. Il est bien plus sécurisant pour eux de s’activer aux manettes plutôt que de poser les bonnes questions.
Or, l’auteur cite Machiavel, qui disait qu’un prince doit toujours être un grand questionneur et un patient écoutant de la vérité sur les choses, et il devrait être en colère s’il trouve que quelqu’un a des scrupules à lui dire la vérité. Ce dont le gouvernement a besoin, c’est de grands questionneurs.
L’accession au pouvoir de Donald Trump ne peut que susciter des inquiétudes. Son habitude de substituer sa vérité à la vérité des faits est préoccupante. Et le jugement de Barbara Tuchman sur les papes de la renaissance pourrait s’appliquer à lui : « l’intérêt purement personnel appartient à toutes les époques, mais il devient folie quand il domine le gouvernement. »

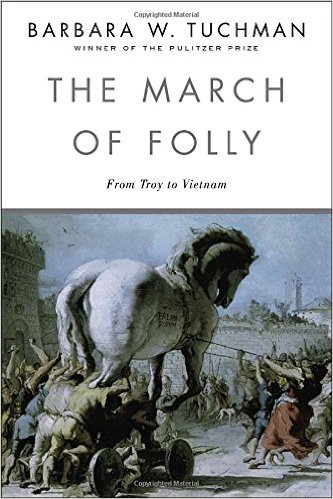

Note géniale ! Et tellement d’actualité. Hélas l’arrivant ne connaît pas Barbara Tuchman. Il va la traiter de nazie.