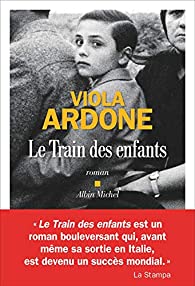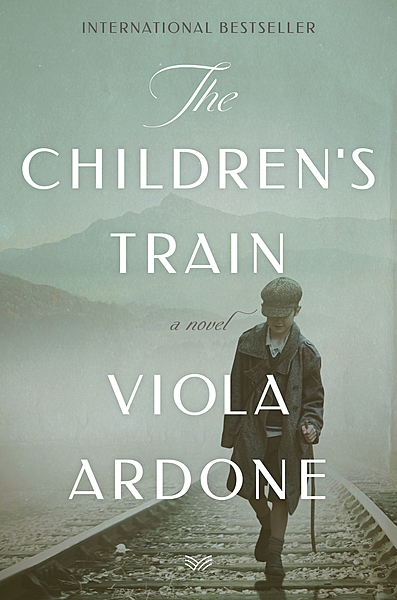« Il treno dei bambini », roman de Viola Ardone (2019, « le train des enfants » dans la traduction française) est un roman poignant sur le destin et l’amour filial.
Comme dans « l’amie prodigieuse » d’Elena Ferrante, il est question dans « le train des enfants » des quartiers populaires de Naples et de chaussures. « Ma maman devant et moi derrière, dit Amerigo Speranza, 7 ans, un jour de novembre 1946. Dans les ruelles des Quartiers espagnols ma maman marche vite : pour chacun de ses pas, un pas pour moi. Je regarde les chaussures des gens. » Les chaussures sont, pour ce petit enfant, ce qui distingue un riche d’un miséreux. Lui n’a jamais eu droit qu’à des chaussures usagées et trouées, faites aux pieds d’autres personnes, qui lui font mal.
Amerigo et sa mère Antonietta survivent en vendant des fripes sur le marché. Antonietta n’a que lui : ses parents sont morts, un fils aîné a succombé à une pneumonie, le père du petit a disparu « en Amérique ». La faim et le froid rôdent.
Le Parti Communiste organise l’accueil d’enfants du Sud par des familles du Nord : environ 70 000 enfants partiront ainsi en train des villes du Mezzogiorno. Ils seront bien nourris, ils auront chaud, ils iront à l’école et ils reviendront dans quelques mois ragaillardis. Les catholiques et les royalistes font courir le bruit que les pauvres enfants iront en Russie, qu’on les mettra dans des fours ou qu’on leur coupera les mains. Mais nécessité fait loi. Beaucoup de parents se laissent convaincre.
Le train des enfants va, de nuit, de Naples à Bologne. Pour Amerigo, c’est ensuite l’autocar jusqu’à Modène. « Je sens les tremblements dans tout le corps, mais je ne sais pas si c’est en raison du froid ou de la peur. » C’est une jeune militante du parti, Derna, qui l’accueille. Elle lui avouera : « quand le maire m’a demandé de prendre un enfant, j’ai répondu non. J’avais peur » La peur au ventre est partagée par l’adulte et par l’enfant.
À Modène, Amerigo est accueilli par la famille Benvenuti comme l’un des leurs. Il dispose d’une chambre à lui, il mange à sa faim, il est valorisé à l’école. Alcide, le père de famille, fabrique des instruments de musique. On lui offre un violon, ce qui le met sur la voie de sa vocation : il sera musicien.
Le retour à Naples à l’été 1947 est douloureux. Amerigo partage le lit de sa mère. Il n’est plus question de musique ni d’école. Il est placé en apprentissage chez un cordonnier. Il s’enfuit par le train et se réfugie dans sa nouvelle famille. « Désormais nous sommes cassés en deux moitiés », observe-t-il à Tommasino, lui aussi partagé entre Campanie et Émilie.
Le livre est conçu comme un récit écrit par Amerigo avec son langage d’enfant. C’est de nouveau Amerigo qui s’exprime en 1994. Il a cinquante-cinq ans et revient à Naples pour les obsèques de sa maman, qu’il n’a pas revue depuis sa fuite à Modène. Il rencontre Maddalena, la militante communiste qui a organisé le train des enfants et qui, aujourd’hui, veille sur Carmine, le fils d’Agostino, son frère cadet. La relation qui s’établit avec le petit garçon, son neveu, lui rappelle le petit garçon qu’il était, allant chercher ailleurs le père qu’il n’avait pas à Naples.
Les derniers chapitres du livre sont comme une lettre qu’écrit Amerigo à sa maman disparue : « toutes les années que nous avons passées éloignés ont été une longue lettre d’amour, chaque note que j’ai jouée, je l’ai jouée pour toi. »
Un personnage formidable est Maddalena, la militante qui haranguait les familles avec un mégaphone pour les exhorter à donner à leurs enfants la chance du voyage vers le nord. En 1994, elle constate : « c’était plus facile autrefois. Il y avait le parti, il y avait les camarades. Aujourd’hui il n’y a plus rien, celui qui veut faire quelque chose de bien doit le faire seul, pour son compte (…) L’histoire avance, mais il devrait rester quelque chose. Cette idée de la solidarité. Tu t’en rappelles ? La so-li-da-ri-té ».
L’une des listes aux élections régionales en Corse avait pour slogan : « les nôtres avant les autres ». En Italie aussi, la solidarité n’est pas de mode : les migrants ne sont pas bienvenus, le Mezzogiorno coûte trop cher. Viola Ardone nous rappelle, par la bouche de Maddalena, « que la faim n’est pas une faute mais une injustice : que les femmes doivent s’unir entre elles pour améliorer les choses. »