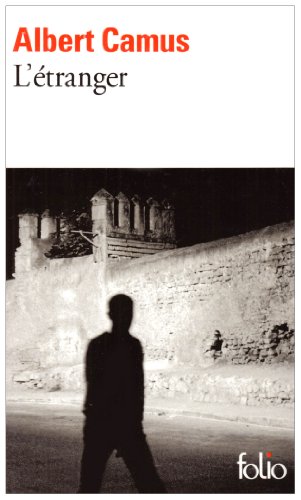« L’Étranger », roman d’Albert Camus (1942) est considéré comme l’un des meilleurs romans en langue française.
On pourrait penser que « l’étranger » doit son titre à la situation du héros, Meursault, Européen dans un pays à majorité musulmane. Ce n’est pas le cas. Meursault se sent chez lui en Algérie, même si les Musulmans sont perçus comme une menace. Sur une plage, aveuglé par l’éclat d’une lame dans le soleil, il fera feu sur un « Arabe ».

Ce qui rend Meursault étranger à son propre peuple, c’est le fait qu’il regarde ce qui lui arrive avec un ennui fataliste : « Le soir, Marie est venue me chercher et m’a demandé si je voulais me marier avec elle. Je lui ai dit que cela m’était égal et que nous pourrions le faire si elle voulait ». C’est aussi qu’il ne sait pas mentir : « Elle a voulu savoir si je l’aimais. J’ai répondu comme je l’avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien mais que sans doute je ne l’aimais pas. »
Pendant son procès d’assises, Meursault est davantage condamné pour ne pas avoir pleuré lors des obsèques de sa mère que pour le meurtre de « l’Arabe ». Il est étranger aux principes de comportement des « gens bien ». Pour son étrangeté, il mérite de mourir.
Les passages du roman consacrés à la détention de Meursault m’ont particulièrement intéressé. « Au début de ma détention, ce qui a été le plus dur, c’est que j’avais des pensées d’homme libre. Par exemple, l’envie me prenait d’être sur une plage et de descendre vers la mer. A imaginer le bruit des premières vagues sous la plante des pieds, l’entrée du corps dans l’eau et la délivrance que j’y trouvais, je sentais tout d’un coup combien les murs de la prison s’étaient rapprochés. Mais cela dura quelques mois. Ensuite, je n’avais que des pensées de prisonnier. J’attendais la promenade quotidienne que je faisais dans la cour ou la visite de mon avocat. Je m’arrangeais très bien avec le reste de mon temps.
(…) Les premiers mois ont été durs. Mais justement, l’effort que j’ai dû faire aidait à les passer. Par exemple, j’étais tourmenté par le désir d’une femme. C’était naturel, j’étais jeune. Je ne pensais jamais à Marie particulièrement. Mais je pensais tellement à une femme, aux femmes, à toutes celles que j’avais connues, à toutes les circonstances où je les avais aimées, que ma cellule se peuplait de tous les visages et se peuplait de mes désirs. Dans un sens, cela me déséquilibrait. Mais dans un autre, cela tuait le temps.
(…) J’avais bien lu qu’on finissait par perdre la notion du temps en prison. Mais cela n’avait pas beaucoup de sens pour moi. Je n’avais pas compris à quel point les jours pouvaient être à la fois longs et courts. Longs à vivre, sans doute, mais tellement distendus qu’ils finissaient par déborder les uns sur les autres.
(…) Le jour finissait et c’était l’heure dont je ne veux pas parler, l’heure sans nom, où les bruits du soir montaient de tous les étages de la prison dans un cortège de silence (…) Non, il n’y avait pas d’issue et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. »