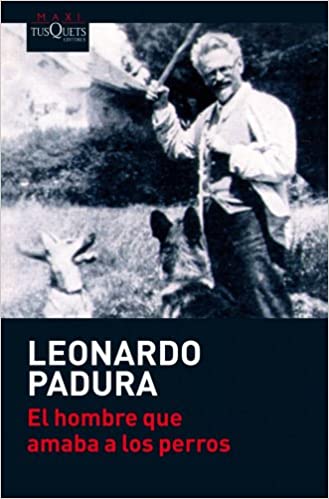Dans « l’homme qui aimait les chiens » (2009), l’écrivain chilien Leonardo Padura raconte les destins croisés de Léon Trostki depuis son exil jusqu’à son assassinat au Mexique, de son assassin Ramón Mercader et d’Iván Cardenas Madurell, un Cubain séduit dans sa jeunesse par l’idéal révolutionnaire, devenu un écrivain frustré et désespéré.
En 1977, Iván Cardenas rencontre sur une plage de La Havane un homme étrange qui se promène avec deux lévriers russes. Iván travaille comme correcteur dans un magazine vétérinaire. La conversation s’engage sur la présence de ces chiens inhabituels sur le territoire cubain. L’homme a besoin de parler. Il est miné par une grave maladie, ses jours sont comptés. Il livre à Iván l’histoire d’un homme qu’il présente comme son ami : Ramón Mercader, l’assassin de Trotski.
Depuis 1929, Lev Davidovitch Bronstein, qui a emprunté à un geôlier son pseudonyme de Trotski, est en exil : d’abord près l’Alma Ata, puis dans l’île turque de Prinkipo dans le Bosphore ; puis à Barbizon en Ile de France ; ensuite en Norvège ; enfin, à partir de 1936, à Mexico, accueilli par le président Cardenas et hébergé par Diego Rivera et Frida Kahlo avant de les quitter pour une maison que sa femme Natalia transforme en forteresse.

Nettoyé par dedans
« Neuf années de marginalisation et d’attaques, écrit Padura, avaient réussi à le convertir en un paria, un nouveau juif errant condamné à la dérision et à l’attente d’une mort infâme quand l’humiliation aurait épuisé son utilité et sa part de sadisme. » Bien qu’isolé, calomnié par les staliniens, traité de traître, de renégat, d’ennemi mortel du prolétariat, Lev Davidovitch fait front. « Malgré ses soixante ans, les tensions et les souffrances physiques, le renégat dégageait de la fermeté et, malgré ses multiples trahisons à la classe ouvrière, de la dignité » doit constater son futur assassin.
L’assassin s’appelle Ramón Mercader. Catalan, il s’est engagé à 23 ans dans l’armée républicaine contre le soulèvement franquiste. Sa mère, Caridad, bourgeoise convertie à la révolution communiste, le convainc de changer de vie. Il passe sous la coupe d’un agent secret soviétique, amant de Caridad. À Majalovska, une base de la Guépéou, il subit un lavage de cerveau : « tu vas apprendre, avant tout, que tu ne reviendras jamais à la personne que tu fus avant d’arriver à cette base. Nous allons te nettoyer par dedans. »
Ramón devient Jacques Mornard, né à Téhéran de diplomates belges. « Son corps, jusqu’alors vide, prit forme et compléta sa structure. Avoir de nouveau des parents, un frère, une ville natale, une école où il avait étudié et pratiqué des sports… »

Préparer la sortie de Trotski du monde
Jacques Mornard est prévenu par son mentor : « le camarade Staline pense qu’est venu le moment… Nous allons préparer la sortie de Trotski du monde. » L’opération requiert du temps. Jacques doit séduire une Américaine secrétaire de Trotski, Sylvia Ageloff, si laide qu’elle n’espérait pas trouver de mari. Il devient son fiancé. C’est elle qui fera de lui un habitué de la maison Trotski. Elle sera, malgré elle, complice de son assassinat.
Le 20 août 1940, Mornard plante un piolet dans la tête de l’exilé. Il est emprisonné et condamné à vingt ans de réclusion. Malgré l’évidence, il ne démord pas de la version que lui a fabriquée son mentor : il s’appelle bien Mornard, il était trotskiste mais il a été déçu lorsqu’il a réalisé que le leader du mouvement travaillait pour une puissance étrangère et préparait l’assassinat de Staline. Il a agi seul. « Si je confessais quelque chose, dira-t-il plus tard, non seulement je me tuais moi-même, mais je tuerais d’autres personnes. Et je me dis que j’allais tout supporter : et je supportai, sans parler »
En prison, Ramón se marie avec une camarade dépêchée par la Guépéou. « Il avait demandé à son avocat qu’il achetât des livres pour étudier l’électricité et apprendre des langues. Les mystères des flux électriques et les vies intérieures des langues l’avaient toujours attiré. » Il participe à un programme d’alphabétisation dont bénéficient 500 détenus.

Une réflexion sur le mal
Le livre de Leonardo Padura est politique. Il établit un parallèle entre l’évolution de l’Union Soviétique et celle de Cuba. Dans les deux cas, tout commence par la ferveur révolutionnaire, le désir brûlant d’une société libérée de l’exploitation. Puis s’instaure la dictature, et avec elle le mensonge. Le rêve communiste s’avère « une réalité inexistante, faite quasi toujours de mots et de consignes, et rarement de de bananes, de patates douces et de citrouilles concrètes. »
Le livre est aussi une réflexion sur le mal. Pour Ramón, la source du mal est sa propre mère : « quelque chose d’imparable avait commencé à croître à l’intérieur de Caridad, la haine, une haine destructrice qui la poursuivrait pour toujours et qui non seulement donnerait sens à sa vie, mais qui modifierait jusqu’à la dévastation celle de chacun de ses enfants ».
En 1968, après l’invasion de la Tchécoslovaquie et la fin du « printemps de Prague », Ramón et son mentor, qui se fait maintenant appeler Eitingdon, se retrouvent à Moscou après avoir purgé, l’un et d’autre, de longues peines de prison. Ils parlent de leur vie réglée par une sainte trinité : obéissance, fidélité, discrétion. Ramón constate qu’on lui a tout pris, son nom, son passé, sa volonté, sa dignité.

La haine, le mensonge, la peur
Comme sa mère, il a été mu par la haine. « Tu ne peux imaginer ce que peuvent faire la haine et la rancœur quand on les alimente bien », fait dire Padura à l’un de ses personnages. Et encore « nous sommes forts, parce que la haine est invincible. » Ramón « était un homme capable de garder silence, d’exploiter sa haine, de ne pas sentir de compassion et de mourir pour la cause. Une machine obéissante et impitoyable. »
Le second ressort du mal est le mensonge. « Si ce que tu dis est mensonge, de toutes manières nous le convertirons en vérité. C’est cela qui importe : que les gens le croient. » « Le mensonge le plus lourd, répété sans que nul le réfute, finit par se transformer en une vérité. »
Le dernier ressort, peut-être le plus puissant, est la peur. Staline avait fait en sorte que nul ne puisse jamais se sentir en sécurité. Padura évoque « ces hommes qui vivraient avec la peur de dire un seul mot à voix haute, d’avoir une opinion, et se verraient obligés à ramper, tournant la tête pour surveiller leur ombre. » Mercader comme Eitingdon savent qu’ils ne peuvent qu’aller au bout de leur mission et que, pour eux, il n’y a pas de retour. Ils vivent sans cesse sous l’empire de la peur.
Ces personnages sont des assassins odieux. Pourtant, ils apparaissent comme des marionnettes aux mains du diable. Méritent-ils la compassion ?
« L’homme qui aimait les chiens », ouvrage de près de 700 pages, est passionnant sous tous ses aspects : historique, politique, psychologique. Il donne froid dans le dos : haine, mensonge et peur ne sont-ils pas encore présents dans la géopolitique du vingt-et-unième siècle ?